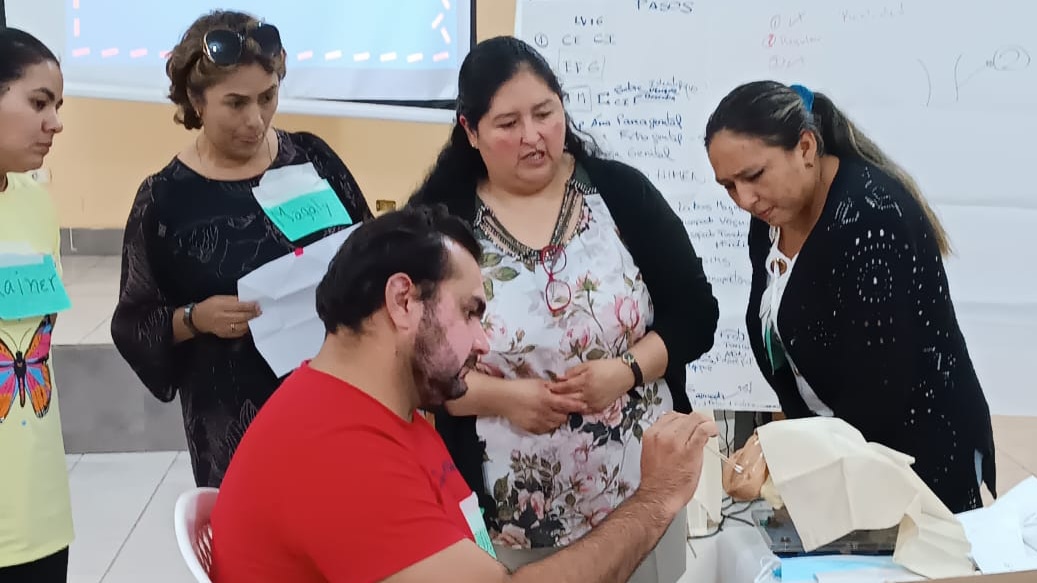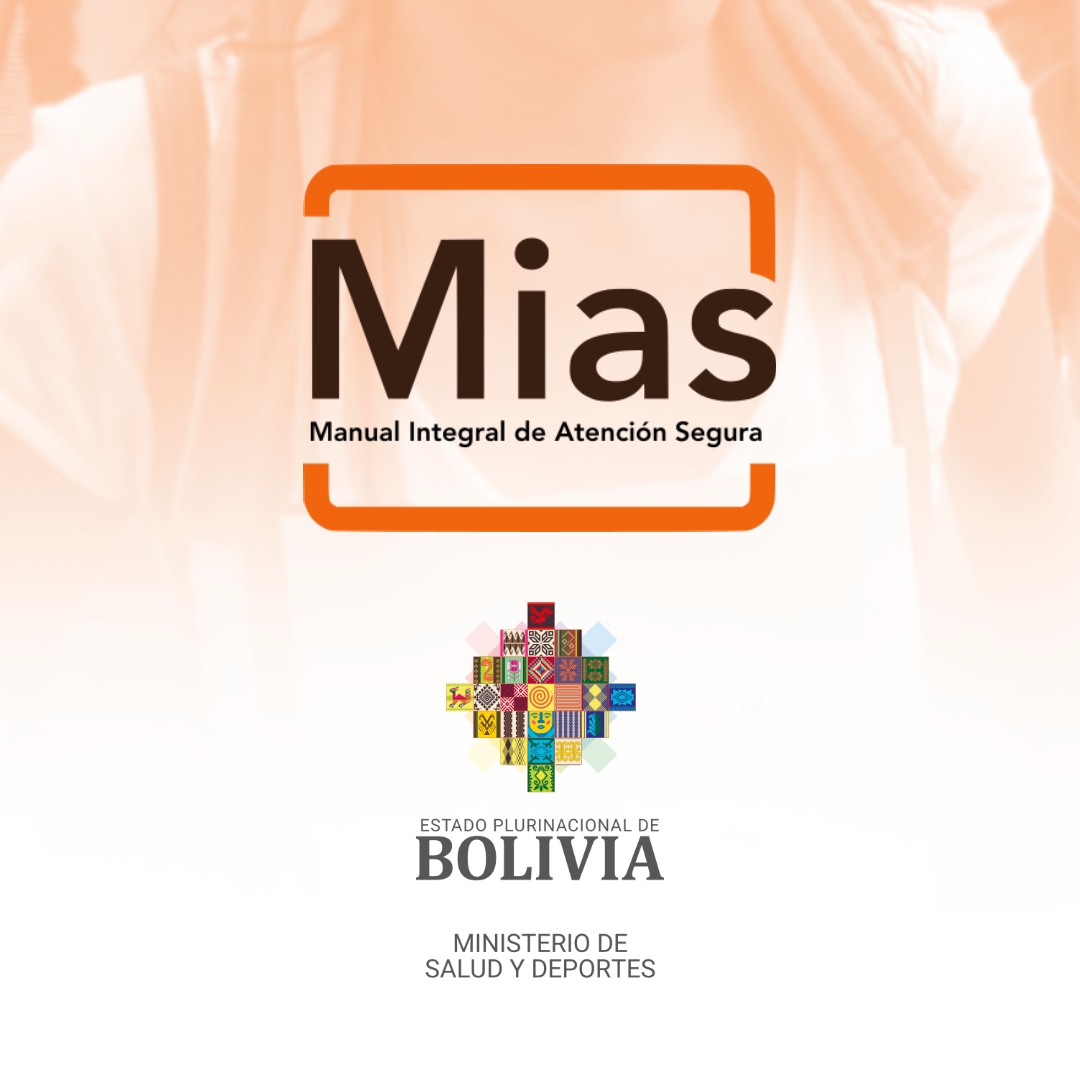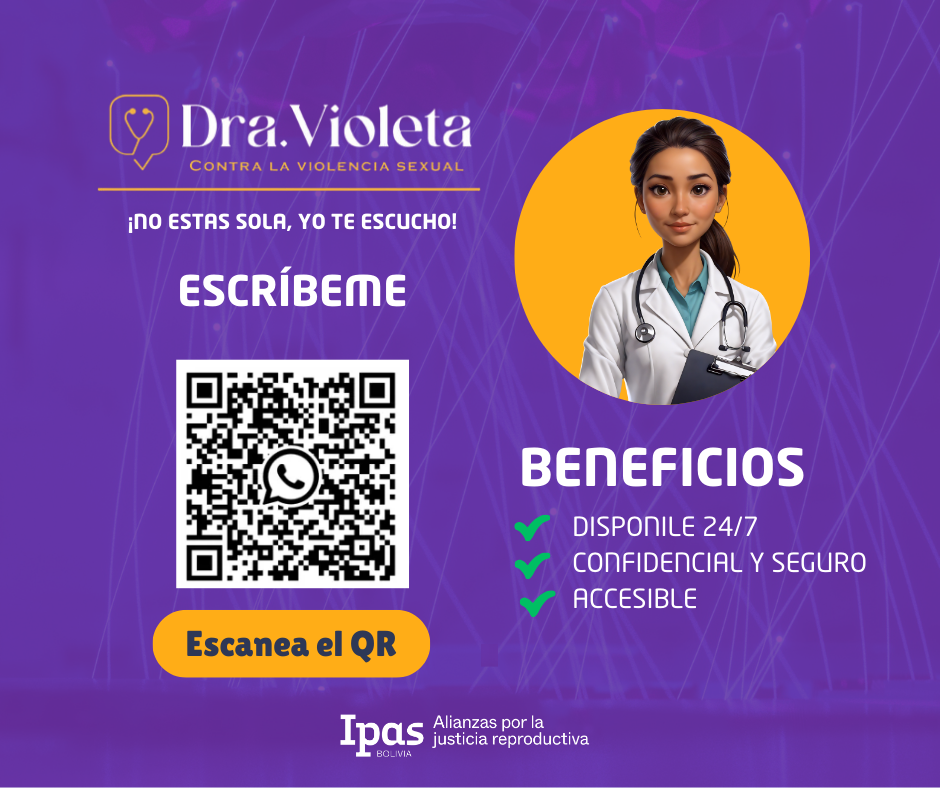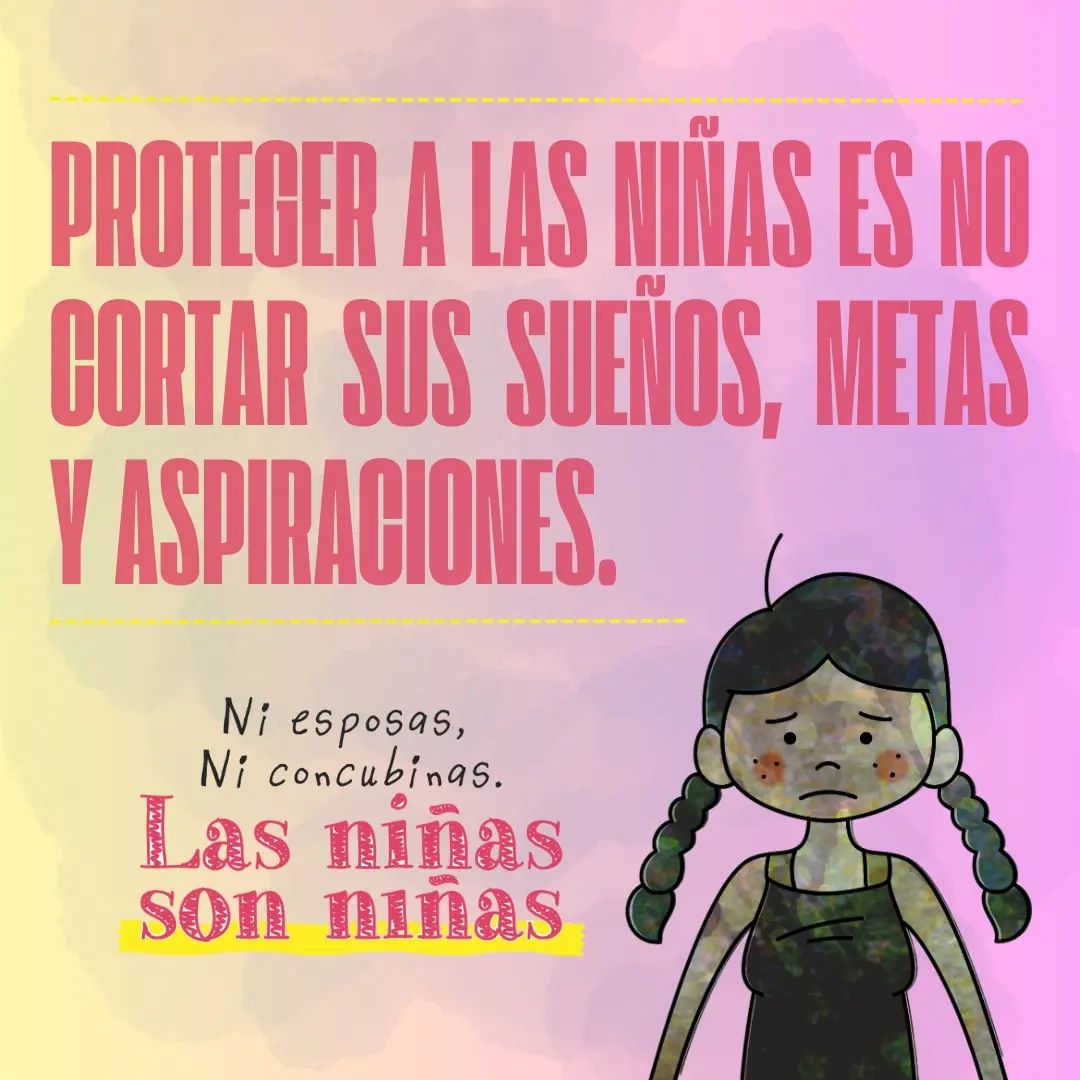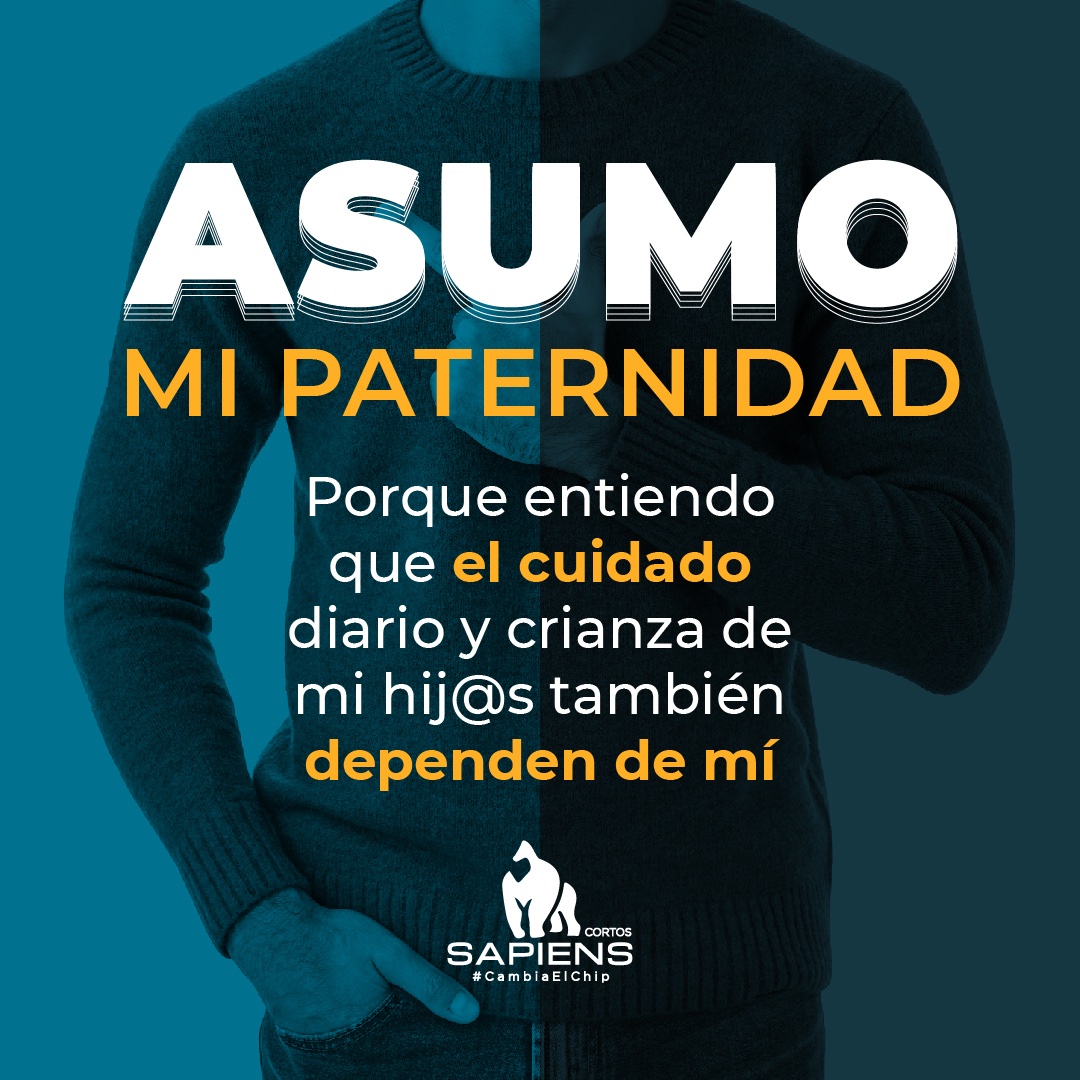Poignardée, vidée de son sang et oubliée. C’est ainsi que Noelia, une femme transgenre de 21 ans, est morte le 30 avril dans une auberge de la ville d’Oruro. Elle a été victime de la haine de son agresseur, un adolescent aux tendances homophobes qui avait planifié son crime quelques jours avant même de la rencontrer. Son corps a été retrouvé deux jours après le crime. La société n’a pas remarqué son absence, tout comme elle n’a pas accepté sa vie.
« Son corps sans vie est resté dans sa chambre pendant deux jours. Ils ne l’ont trouvée que parce qu’il était temps de percevoir le loyer. Combien de temps allons-nous mourir ainsi ? », dit l’une de ses compagnes.
Le cas de Noelia n’est qu’un des 21 transféminicides - sur 28 crimes de haine - enregistrés au cours des 15 dernières années en Bolivie. Les données sont tirées des statistiques de l’Observatorio de los Derechos LGBT et d’un examen des rapports de presse effectué par Visión 360 pour cet article.
« Lorsque nous parlons d’un crime d’une grande violence et d’une grande haine, nous parlons également d’un message adressé à la population LGBTIQ+, à savoir qu’elle ne peut pas vivre.
Stephanie Llanos d’Adesproc
Mais il ne s’agit là que des cas avérés. Dans la mémoire collective de la population lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer (LGTBIQ+), le nombre de personnes tuées en raison de préjugés à l’encontre de leur identité sexuelle dépasse les 70.
« Ces données ne sont pas ventilées en fonction de l’orientation ou de l’identité au sein du ministère public, du parquet, de la police ou de toute autre entité publique. C’est pourquoi nous avons créé l’Observatoire », a déclaré Stephanie Llanos, de l’Asociación de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad GLBT.
Les transgenres et la violence
Comme Noelia, Gabriela, 19 ans, a été assassinée en 2020 dans un foyer d’El Alto, avec une extrême violence. Le tueur l’a poignardée 19 fois, avec une telle violence qu’il ne lui a laissé aucune chance. Il s’est enfui sans laisser de traces.
Originaire de Beni, Gabriela est arrivée à La Paz à la recherche d’une opportunité. Comme beaucoup, elle fuyait un environnement qui la rejetait parce qu’elle était elle-même.
Un cas antérieur à la mort de Gabriela s’est également produit à El Alto en décembre 2018, lorsque la femme transgenre Litzy Hurtado a été assassinée dans une discothèque. Elle a d’abord été agressée par un groupe d’hommes avant d’être poignardée à mort par l’un d’entre eux à l’aide d’un tournevis.
Plusieurs pays de la région ne disposent pas d’informations sur la situation sociale de la population transgenre. C’est pourquoi, en 2015, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a recommandé aux gouvernements, y compris au gouvernement bolivien, de recueillir des informations statistiques sur la violence à l’encontre des personnes LGBT.
Les quelques données obtenues indiquent que l’une des formes les plus extrêmes de stigmatisation et de discrimination est la violence sociale et institutionnelle. Bien qu’il s’agisse d’un mal qui touche l’ensemble de la population, les personnes transgenres souffrent de manière disproportionnée, en tant que victimes de crimes de haine et en raison de l’impunité dont jouissent ces crimes.
« Depuis 2018, nous réalisons des rapports nationaux sur la violation des droits humains de la population transgenre en Bolivie. Malheureusement, nous avons constaté un nombre très élevé de plaintes. Rien que cette année, nous avons constaté deux crimes de haine. Nous vivons dans un contexte de violence et de mépris, en particulier dans le cas des femmes trans », explique Moira Andrade, directrice générale de Red Trebol de Bolivie et référente nationale du Réseau latino-américain et caribéen des personnes trans.
33 % de la population LGTBIQ+ ayant participé à la première enquête virtuelle ont déclaré ne pas avoir de couverture médicale, les femmes transgenres étant les plus touchées.
Il affirme qu’il y a une absence de la part de l’État et des autorités et un manque de respect des lois établies ces dernières années. Cela signifie que cette population n’a pas accès à la santé, à l’éducation, au travail ou à une justice complète, car les crimes de haine et les différents types de violence restent impunis.
Transféminicides
Le 9 novembre 2016, à la suite du meurtre de Dayana par son partenaire (Santa Cruz), des membres de la population LGTBIQ+ ont organisé une série de manifestations. Lors des marches, ils ont demandé que les meurtres de femmes transgenres soient classés comme des fémicides, en respect de leur identité.
Le cas de Dayana est l’un des plus cruels où les autorités font preuve de négligence. Bien que son compagnon l’ait volée, torturée et égorgée, après examen de son corps, elles ont transformé l’affaire de féminicide en « homicide par jalousie ».
Lorsque la police a retiré son corps, elle a qualifié le crime de féminicide, mais lors de l’autopsie, elle a constaté que, bien qu’elle ait eu des seins, ses organes génitaux masculins étaient toujours présents. Malgré son identité de genre, il a été déclaré qu’elle était un homme et que la figure ne correspondait pas.
« Lorsqu’une personne est retrouvée morte, on ne l’identifie qu’en fonction de ses organes génitaux. C’est pourquoi, pour nous, l’un des plus grands défis est d’avoir accès à la justice », déclare Llanos.
Paola Tapia, responsable de l’unité « Populations vulnérables et diversité sexuelle » du bureau du médiateur, reconnaît qu’il n’existe pas de données officielles parce que les autorités n’enregistrent pas les victimes en fonction de leur identité sexuelle. Elle indique qu’elles s’appuient sur les documents d’identité officiels (carte d’identité), qui souvent ne mentionnent pas l’identité sous laquelle les victimes vivaient ou étaient connues.
« En outre, la plupart de ces affaires n’aboutissent pas à des condamnations ou même à des inculpations formelles des auteurs. Elles sont oubliées ou classées par le ministère public. Nous pouvons citer quelques cas qui n’ont pas encore été jugés : Alessandra Ferreti, Santa Cruz (2021), Gabriela Ramírez El Alto (2020), Litzy Hurtado El Alto (2018) », précise-t-il.
Une deuxième tentative pour obtenir la classification de féminicide a eu lieu en 2021, après le meurtre d’Alessandra dans un logement de Cochabamba. Elle venait d’arriver de Santa Cruz, était victime de discrimination et ne trouvait pas de travail. Elle s’est donc consacrée à la seule chose qui lui ouvrait des portes, le travail du sexe. Un matin, ses collègues l’ont trouvée sans vie dans sa chambre, asphyxiée avec le cordon d’un sèche-cheveux.
Les tentatives pour obtenir justice en vertu de la définition du féminicide ont été vaines.
Noelia, premier féminicide
« Ce meurtre (de Noelia) est un féminicide, le troisième à Oruro jusqu’à présent en 2024 », a déclaré le procureur départemental d’Oruro, Aldo Morales.
Pour la communauté LGBTIQ+, cette reconnaissance est très importante. Pour la première fois, le meurtre d’une femme transgenre peut être qualifié de féminicide.
« À ce jour, seuls deux cas de crimes de haine contre la population LGTBIQ+ ont été condamnés, tous deux pour homicide. Dans le cas de Noelia, à Oruro, une enquête a été ouverte pour fémicide, mais aucune condamnation n’a encore été prononcée. Dans ce cas, les médias et les autorités ont respecté l’identité de genre de la victime », explique M. Llanos.
Pour Andrade, s’il existe une définition du féminicide, il est regrettable qu’il n’y ait pas de phrase incluant la définition du transféminicide. Cela permettrait, selon lui, de rendre plus visible la situation de cette population.
« Nous devons continuer à exiger des politiques publiques et à dénoncer l’absence de l’État », dit-elle, consciente qu’un long combat les attend encore.
Du côté du bureau du médiateur, M. Tapia indique que pour éviter l’impunité, il est nécessaire que les opérateurs de la justice fassent leur travail, sans stéréotypes ni préjugés.
« Nous devons avoir des juges, des procureurs et des policiers qui comprennent les violations des droits de l’homme auxquelles sont confrontées les personnes LGBTI. Nous devons respecter l’orientation sexuelle et l’identité de genre des victimes, cesser de les enregistrer comme des « hommes déguisés en femmes » et comprendre que les femmes transgenres peuvent également être victimes de violences machistes qui peuvent les conduire à mettre fin à leurs jours », ajoute-t-elle.
La situation des personnes LGBTIQ+ est « à la traîne »
Selon le bureau du médiateur, en général, l’exercice des droits des personnes LGBTI en Bolivie est toujours à la traîne. Il a été indiqué que des écarts d’inégalité persistent pour cette population par rapport aux autres.
L’année dernière, le bureau du médiateur a présenté les résultats de la première enquête virtuelle sur la population LGBTI du pays, qui portait sur 11 questions.
Par exemple, 33 % de la population interrogée a déclaré ne pas avoir de couverture médicale, les femmes transgenres étant les plus touchées », a déclaré Paola Tapia, chef de l’unité « Populations vulnérables et diversité sexuelle ».
Malheureusement, la plupart des participants ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas les conditions et les procédures d’adhésion au SUS. Cela signifie que cette population n’est pas protégée et qu’elle est invisible dans les statistiques officielles de l’État en matière de santé.
8 lois sont entrées en vigueur en 15 ans. De la loi 807 sur l’identité de genre aux lois 348 et 045 contre le racisme et toutes les formes de discrimination.
« La situation du droit à l’éducation de la population est une autre question qui mérite une attention urgente. Vingt-huit pour cent de la population participante ont un niveau d’éducation supérieur au lycée, et cinq pour cent n’ont pas terminé l’école secondaire », a-t-il déclaré.
39,7% de la population interrogée a indiqué qu’elle n’était engagée dans aucune activité éducative. La principale raison est le manque de ressources financières. Ces contraintes économiques les obligent à recourir au commerce du sexe comme moyen de subsistance.
En outre, 53 % d’entre eux ont déclaré avoir été victimes de discrimination au cours de l’année écoulée.
« C’est pourquoi le bureau du médiateur considère que l’État devrait mettre en place des mesures positives différenciées pour encourager ou améliorer les conditions de vie de cette population », a déclaré M. Tapia.