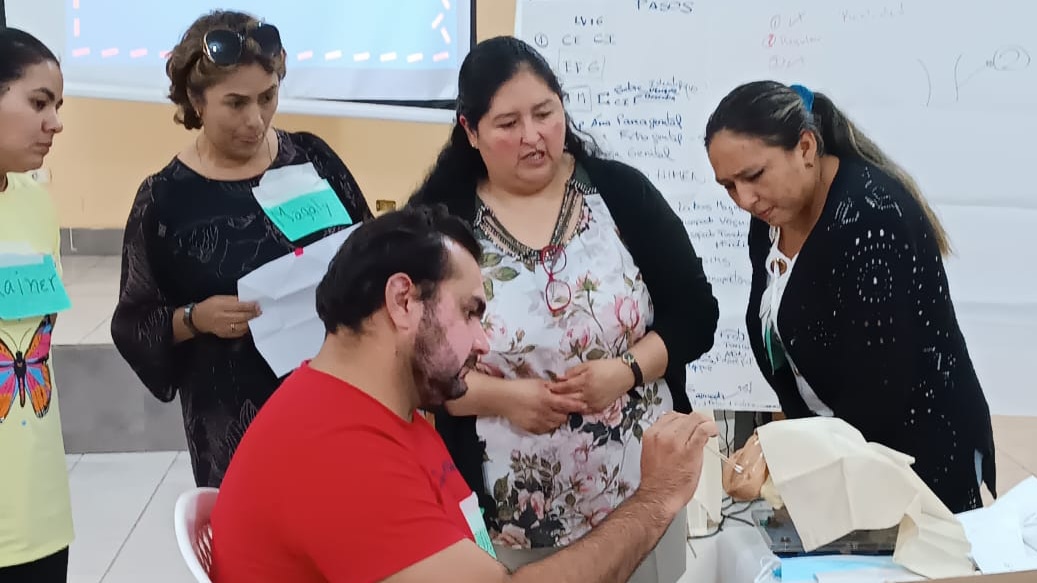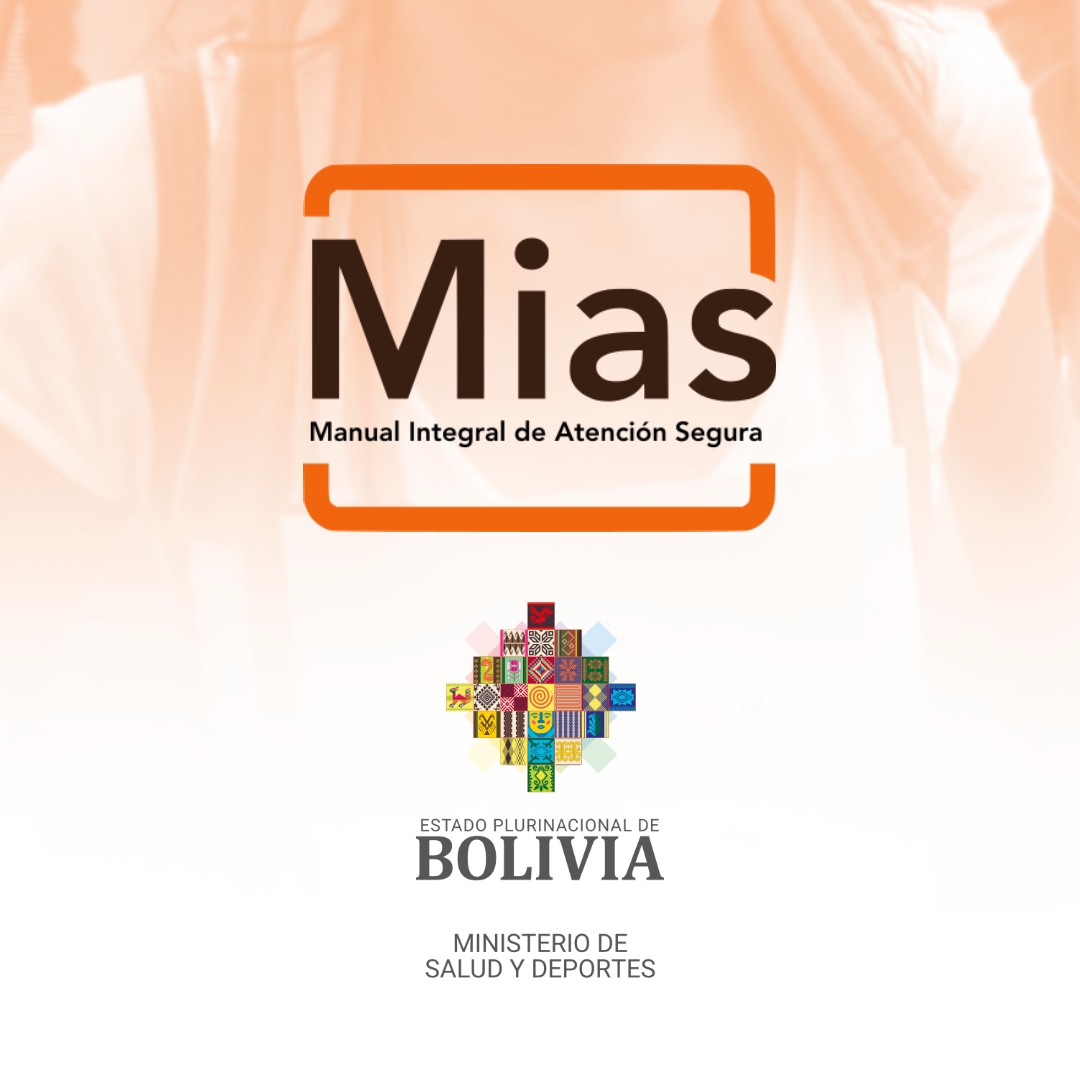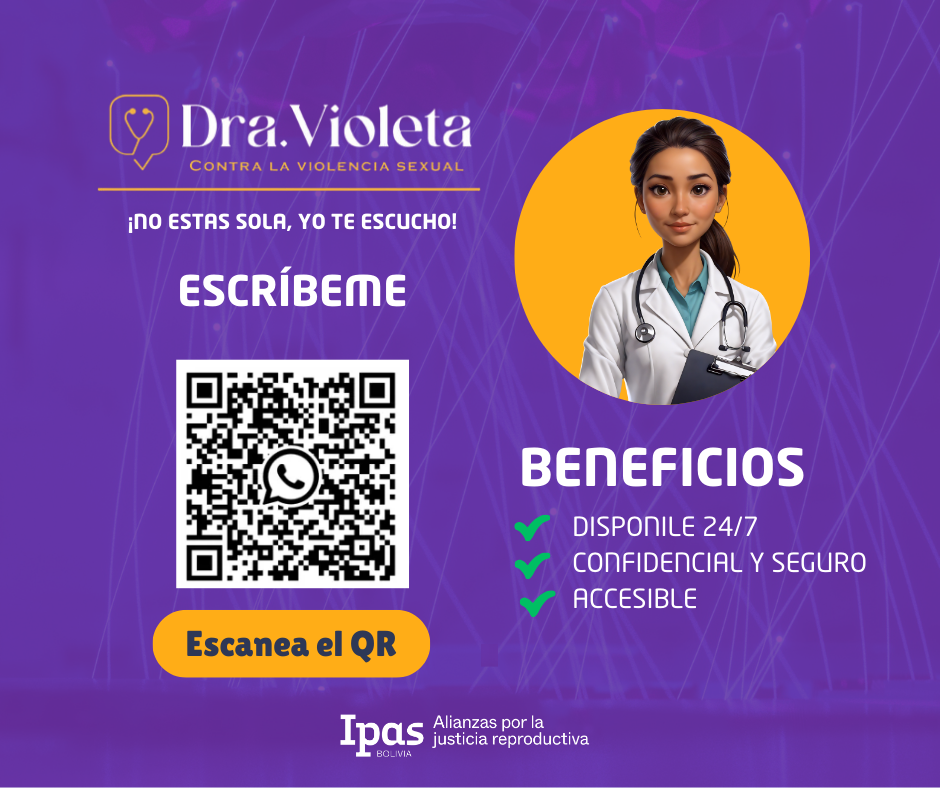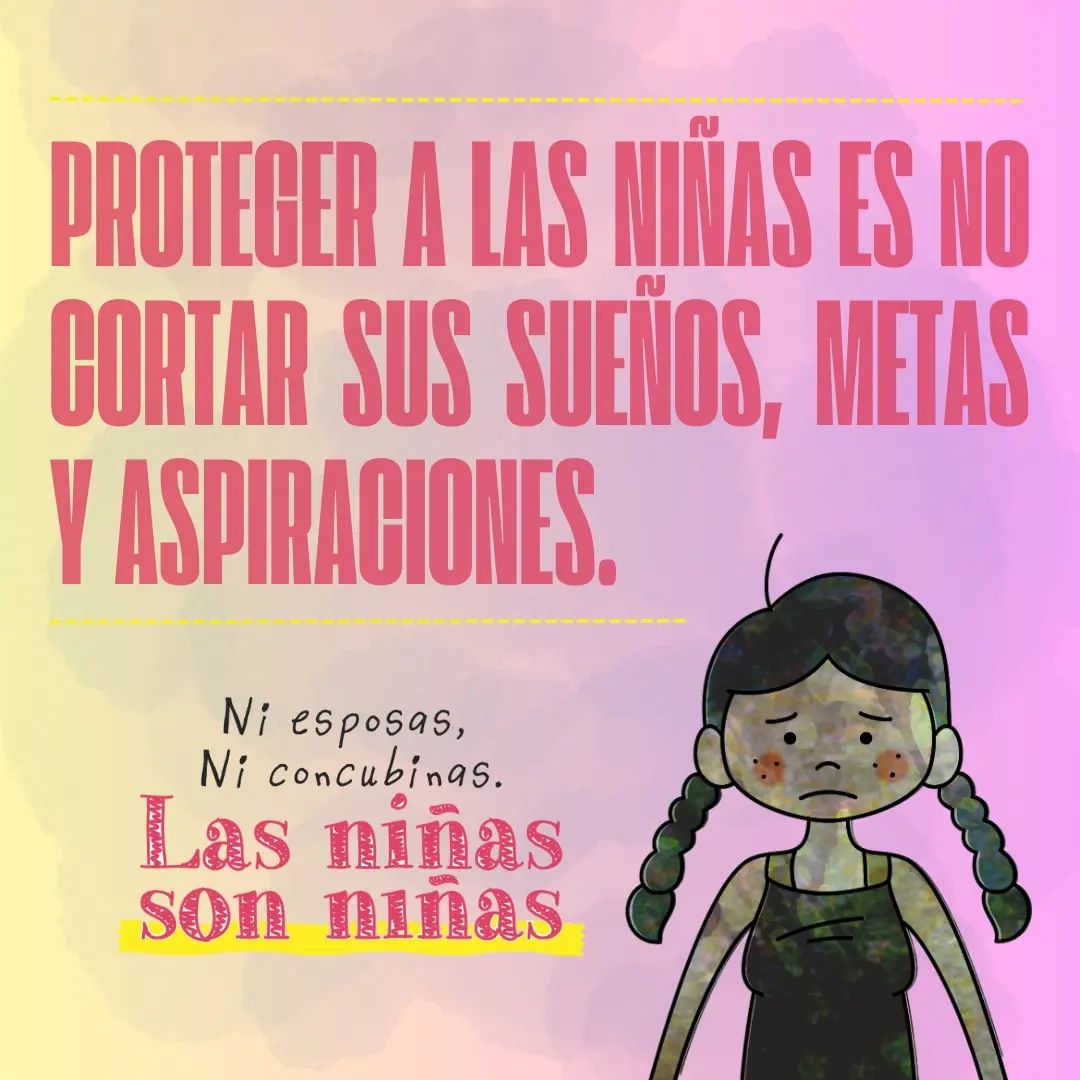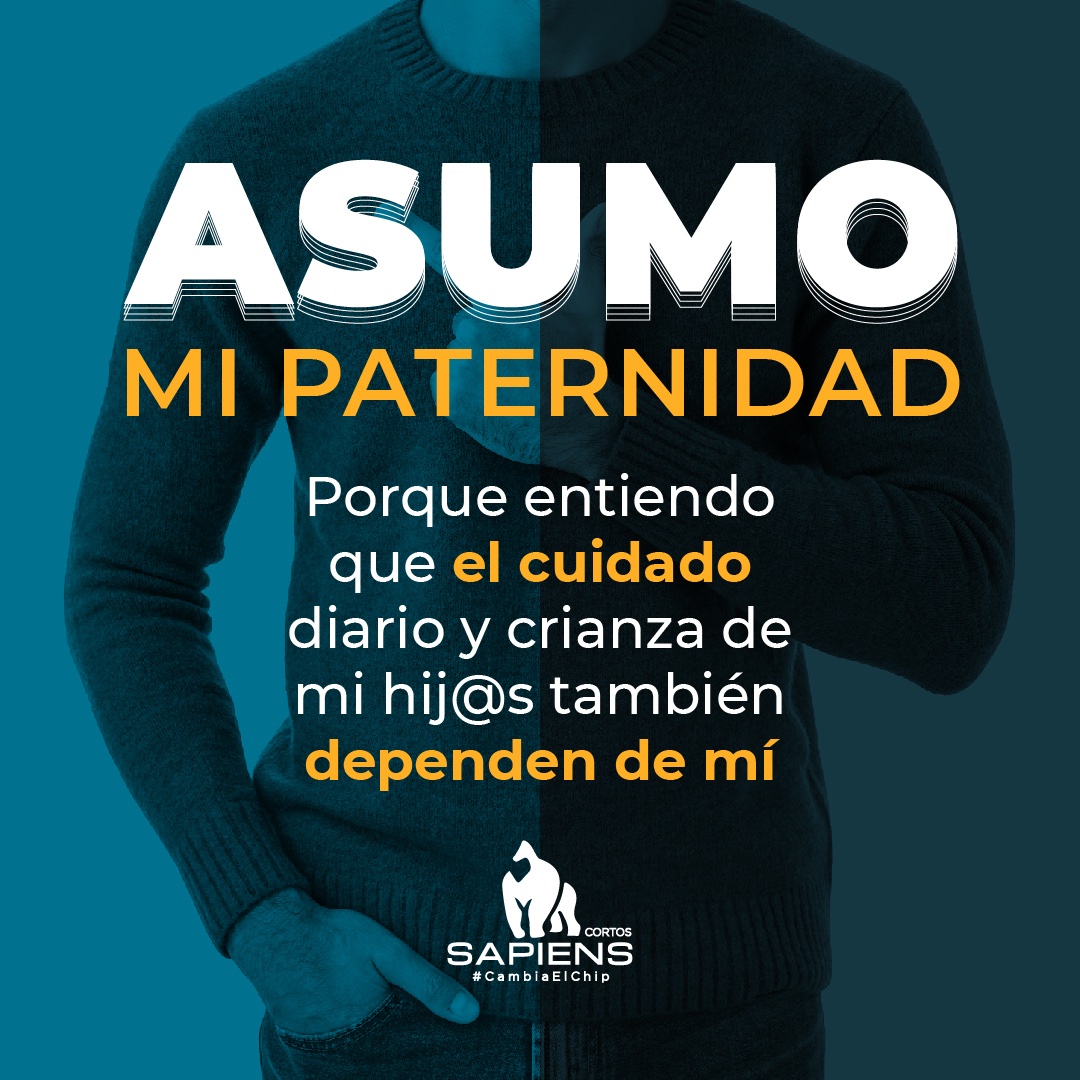Par Mariela Cossío Mercado
Lía a 11 ans et était enceinte. Ce n’est qu’après 22 semaines de gestation que sa mère a découvert son état, après avoir consulté un médecin en raison d’une croissance abdominale qu’elle trouvait inhabituelle. La jeune fille a eu accès à l’interruption légale de grossesse (ILE), une procédure protégée par la loi, mais qui se heurte encore à des difficultés en Bolivie, principalement en raison d’un manque de connaissances non seulement parmi les victimes et leurs familles, mais aussi parmi les prestataires de soins de santé et les autres secteurs concernés.
Lía est un pseudonyme utilisé dans ce rapport pour protéger l’identité de la mineure. À l’hôpital Mexico de Sacaba, elle est la quatrième fille à avoir subi un avortement depuis le début de l’année. Selon le directeur de l’hôpital, Juan Carlos Balderrama, l’hôpital a traité un nombre important d’adolescentes tombées enceintes à la suite d’un viol, de relations entre pairs ou d’un détournement de mineur.
En Bolivie, une femme, une jeune fille ou une adolescente peut demander un avortement en vertu de l’arrêt constitutionnel plurinational 0206/2014 lorsque la grossesse présente un risque pour la vie, la santé physique, sociale ou mentale ou si elle résulte d’un inceste, d’un détournement de mineur ou d’un viol.
Lía remplissait toutes ces conditions. Après avoir découvert la grossesse, sa mère s’est rendue à la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Sacaba, munie d’une échographie qui a confirmé l’âge gestationnel. C’est alors que la jeune fille a réussi à surmonter ses craintes et à rompre le silence, révélant que son cousin de 15 ans l’avait agressée sexuellement à trois reprises. Lia bénéficie à présent d’un soutien psychologique pour l’aider à se rétablir.
D’autre part, l’adolescent impliqué, issu d’une famille dysfonctionnelle et orphelin de père, est en détention provisoire au centre de réinsertion sociale de Cometa. Il vivait depuis près de trois ans avec son oncle et sa tante, qui sont les parents de la victime. Le jeune homme travaillait avec son oncle jusqu’à il y a environ deux mois, lorsque l’affaire a été révélée.
Le cas de Lía est l’un des rares, par rapport au taux de grossesse chez les adolescentes, dans lequel l’arrêt constitutionnel 0206/2014 a été appliqué. En outre, les jeunes filles qui cherchent à se faire avorter sont confrontées à une série de préjugés moraux. D’autres, par peur, arrivent à l’hôpital lorsque leur corps ne peut plus cacher la grossesse et accouchent.
Pamela, dont le nom a été modifié pour protéger son identité, a 14 ans, soit trois ans de plus que Lía, mais elle est déjà mère d’un bébé d’un peu plus de deux mois. L’adolescente a été victime d’un acte de violence sexuelle perpétré par son oncle dans une communauté proche de la ville de Cliza, Valle Alto de Cochabamba. L’homme l’a incitée à cueillir des escariotes (courgettes), où il l’a agressée sexuellement et l’a menacée pour qu’elle ne parle pas. À la suite de ces abus, la mineure est tombée enceinte.
L’adolescente a finalement révélé le nom de son agresseur, qui se cachait dans une ville de la région de Tropic. La police a réussi à le capturer le 1er août à Ivirgarzama. Peu après, une autre plainte a été déposée contre lui : la jeune sœur de Pamela, âgée de 13 ans, en était à son sixième mois de grossesse. Elle avait également été victime du beau-oncle.
Pamela ne savait pas qu’elle avait le choix d’interrompre ou non sa grossesse. Elle vivait dans la peur et sous la menace.
MOYENNE : UN ILE TOUTES LES 21 HEURES
Lía est l’une des 13 filles, âgées de 10 à 14 ans, qui ont opté pour une interruption légale de grossesse (ILE) à Cochabamba entre janvier et juillet de cette année.
Rossemary Grágeda, responsable de l’Unité des enfants, des écoles et des adolescents du Service départemental de santé (SEDES), a indiqué que 248 interruptions de grossesse avaient été pratiquées sur des filles et des adolescentes (âgées de 10 à 19 ans) au cours des sept premiers mois de l’année, ce qui équivaut à un avortement toutes les 21 heures.
Il a précisé que 13 cas concernaient des filles âgées de 10 à 14 ans, tandis que 235 cas concernaient des adolescents âgés de 15 à 19 ans.
Les 13 situations affectant des filles âgées de 10 à 14 ans ont été signalées dans huit municipalités : trois à Cercado, trois à Quillacollo et deux à Chimoré. Les autres cas ont été répartis entre Sacaba, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Punata et Villa Tunari.
En ce qui concerne les avortements pratiqués sur des adolescentes âgées de 15 à 19 ans, 68 ont été réalisés à Cercado, 40 à Quillacollo, 26 à Puerto Villarroel, 16 à Villa Tunari, 15 à Punata, 14 à Sacaba, 11 à Vinto, 6 à Colcapirhua, 6 à Cliza, 5 à Colomi, 5 à Aiquile et 4 à Capinota. En outre, Arque, Ayopaya et Cocapata ont signalé un cas chacun.
Selon Grágeda, les victimes qui ont eu recours à cette procédure n « étaient pas enceintes de plus de quatre mois, c’est-à-dire qu’aucune d’entre elles n » était enceinte de plus de 22 semaines.
La sentence constitutionnelle 0206/2014 dépénalise l’interruption légale de grossesse en Bolivie lorsque la vie ou la santé de la femme est en danger ou si elle a été victime de violences sexuelles, mais n « établit pas l » âge gestationnel limite pour son exécution. Cette situation a généré des incertitudes et des interprétations différentes. Le bureau du médiateur considère qu’il est nécessaire que l’Assemblée législative plurinationale légifère sur la question afin de déterminer le délai maximum dans ces cas, par le biais d’une loi sur les droits sexuels et reproductifs.
Dans son rapport 2020 intitulé Status of Legal Termination of Pregnancy as a Human Right for Women, le bureau du médiateur a demandé à 75 gynécologues jusqu « à quelle semaine une interruption légale de grossesse peut être pratiquée médicalement ou jusqu » à quelle semaine ils ont pratiqué une interruption légale de grossesse. Les réponses varient, mais 32% ont répondu jusqu « à 22 semaines, 27% jusqu » à 20 semaines, 16% jusqu « à 12 semaines, 10% n’ont pas répondu ou ne connaissaient pas l’information, 9% jusqu » à 22 semaines, 3% jusqu « à 18 semaines et 3% jusqu » à 8 semaines.
Cela signifie que la décision d’interrompre la grossesse d’une fille ou d’une adolescente victime de violences sexuelles, enceinte de plus de 22 semaines, appartient aux professionnels de la santé. Le témoignage d’une fonctionnaire de la Force spéciale de lutte contre la violence (FELCV), qui a préféré garder son identité confidentielle, confirme que ce sont les médecins qui prennent la « décision finale ». « Certains médecins sont réticents à pratiquer cette intervention, surtout lorsque la grossesse a dépassé 22 semaines. La première chose que nous faisons lorsqu’une victime arrive est donc de déterminer à quel stade de la grossesse elle se trouve. Dans certains cas, nous demandons l’aide d’organisations qui promeuvent les droits sexuels et génésiques.
La plupart des médecins refusent de pratiquer l’intervention après 22 semaines, s’appuyant sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui considère « l’avortement comme l’interruption de grossesse spontanée ou provoquée avant 22 semaines ».
Dans certains centres médicaux, la position est inflexible. C’est le cas de la maternité Germán Urquidi, où, selon son directeur Antonio Pardo, l’avortement n’est pas pratiqué si la grossesse est avancée de plus de 22 semaines. Le médecin a cité le cas d’une fillette de 12 ans arrivée de Santiváñez à 29 semaines de grossesse. Malgré la demande du bureau du médiateur d’interrompre la grossesse, la mineure a été transférée dans un autre hôpital, un hôpital de deuxième niveau.
« Il s’agit d’une grossesse de sept mois, qui ne peut donc pas être interrompue. Le bureau du médiateur fait pression pour que la procédure soit pratiquée quel que soit l’âge gestationnel, mais le bureau du médiateur des enfants estime que nous commettons un homicide. Ni le ministère de la santé ni les autres autorités ne savent quoi faire. La situation n’est pas claire. Pour notre part, nous invoquons la procédure technique de prestation de services de santé dans le cadre de la sentence constitutionnelle plurinationale 0206/2014 », a-t-elle déclaré, tout en montrant le document et en lisant le concept d’avortement.
Mme Pardo a également rappelé une affaire pénale datant de juin 2022. Le conseil médical a décidé de ne pas interrompre une grossesse de 28 semaines. L’affaire concernait une jeune fille de 12 ans qui avait été violée par son beau-grand-père à Chimoré. Bien que le bureau du médiateur ait demandé l’interruption de la grossesse, le DNA de Cochabamba a préconisé de « sauver les deux vies ».
Quelques jours plus tard, les médecins ont été contraints de pratiquer une césarienne d’urgence en raison de problèmes liés au rythme cardiaque du bébé et d’un cordon ombilical emmêlé autour de son cou. Le prématuré est décédé quatre jours plus tard. Cette affaire a suscité des débats parmi les militants, les organisations, les médecins et les avocats, ainsi qu’une enquête pour mort injustifiée menée par le ministère public.
Pardo et Grágeda partagent la même position : l’avortement n’est pas pratiqué après 22 semaines de gestation. Le premier évoque des « lacunes » dans la réglementation et se réfère à la procédure technique pour la prestation de services de santé dans le cadre de l’arrêt constitutionnel plurinational 0206/2014. « Selon l’OMS, l’avortement est la perte du produit de la gestation depuis le moment de l’implantation jusqu’à ce qu’il atteigne 500 grammes ou 22 semaines de gestation, calculée par la date de la dernière période menstruelle ou par une échographie précoce.
Dans le même document, l’avortement est défini comme « l’interruption de grossesse lorsqu’elle met en danger la santé ou la vie de la femme, qu’il existe des malformations congénitales, qu’elle est mortelle, qu’elle résulte d’un viol, d’un détournement de mineur ou d’un inceste ».
Le médecin affirme qu’un seul avortement a été pratiqué à la maternité Germán Urquidi depuis le début de l’année.
L’arrêt constitutionnel 0206/2014 établit que les victimes de viol n’ont pas besoin d’une autorisation judiciaire pour avorter, il leur suffit de présenter une copie de la plainte déposée auprès de la police ou du parquet, accompagnée d’un consentement éclairé. Dans les cas où la vie de la femme est en danger, un rapport médical et un consentement suffisent.
Le personnel de santé a l’obligation de se conformer à la loi dans les 24 heures suivant la demande de service, en garantissant la confidentialité et le respect de la vie privée du patient. Si un médecin refuse de pratiquer la procédure, il s’expose à des sanctions administratives et pénales pour manquement à ses devoirs et à ses fonctions.
Selon Ipas Bolivia, qui s’appuie sur les données du ministère de la santé, 1 050 ILE ont été pratiquées en Bolivie en 2022, dont 78 % chez des enfants de moins de 15 ans.
Les travailleurs de la santé sont préoccupés par les grossesses chez les adolescentes et appellent à des politiques publiques pour réduire les taux. Mme Pardo reconnaît que les cas sont nombreux. Elle a rappelé le cas d’une jeune fille de 14 ans admise à l’hôpital pour accouchement. La jeune fille a subi une micro-césarienne et le bébé a été placé dans un programme d’adoption.
En Amérique latine et dans les Caraïbes, la mortalité maternelle est l’une des principales causes de décès chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans. Les adolescentes de moins de 15 ans sont jusqu’à trois fois plus susceptibles de mourir de complications liées à la grossesse que les femmes de plus de 20 ans. En outre, les bébés nés de mères adolescentes présentent une prévalence plus élevée de naissances prématurées et de mortalité néonatale.
MATERNITÉ FORCÉE
À Cochabamba, le nombre de grossesses chez les adolescentes est alarmant. En 2022, 5 747 grossesses ont été enregistrées chez des filles et des adolescentes âgées de 10 à 19 ans, ce qui représente 13 % de la population totale de cette tranche d « âge, selon Rossemary Grágeda, responsable de l’Unité de l’enfant, de l » école et de l’adolescent.
La plupart des grossesses chez les adolescentes sont concentrées dans la région métropolitaine, avec 2 929 cas. Viennent ensuite les vallées, avec 507 cas, les Tropiques, avec 1 247 cas, la zone andine, avec 450 cas, et le Cône Sud, avec 614 cas.
En 2022, 15 à 16 grossesses d’adolescentes ont été signalées en moyenne chaque jour. Les données de janvier à juillet de cette année sont encore en cours de traitement, mais l’augmentation est estimée entre 14 et 15 %, selon Grágeda. Cela signifie que même pas 8 % des mineures enceintes à Cochabamba ont accès à l’avortement.
Le directeur de la maternité Germán Urquidi, Antonio Pardo, a indiqué qu’en 2022, 81 adolescentes enceintes âgées de moins de 18 ans avaient été prises en charge. Cependant, à la mi-août 2023, il y avait déjà plus de 126 cas, dépassant le chiffre de l’année précédente. La plupart des patientes ont entre 15 et 16 ans, mais des filles de 12 ans ont également été traitées pour des grossesses résultant d’un viol. Depuis le début de l’année, au moins sept cas de ce type ont été signalés.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la mairie de Cochabamba reconnaît également que les taux de grossesse chez les adolescentes sont élevés. La directrice de cette agence, Cynthia Prado, rapporte que presque chaque jour, une adolescente enceinte se présente dans les centres de santé de la municipalité. Les cas traités sont dus à des viols et à l’ignorance des méthodes contraceptives. C’est pourquoi l’AND travaille à l’élaboration d’un plan d’action pour atteindre les adolescents.
5 ANS : PLUS DE 39 000 FILLES ET ADOLESCENTES SONT ENCEINTES.
Selon les données du Service national d’information sanitaire - Surveillance épidémiologique (SNIS-VE), partagées par Grágeda, 39 502 grossesses ont été enregistrées à Cochabamba chez des filles et des adolescentes âgées de 10 à 19 ans au cours des cinq dernières années, de 2018 à 2022.
En 2021, il y avait 6 647 grossesses connues, ce qui représente 15 % de la population totale de ce groupe d’âge. En 2020, on dénombre 7 065 grossesses (15 %), en 2019, 9 217 (16 %) et en 2018, 10 826 (18 %).
Bien que les statistiques montrent une légère diminution, il existe des preuves de la sous-déclaration des grossesses chez les adolescentes. Par exemple, il existe des cas de filles et d’adolescentes enceintes qui n’ont pas accès aux soins médicaux ou qui subissent des avortements clandestins.
En Bolivie, l’avortement clandestin est l’une des principales causes de décès maternel. Cependant, il n’existe pas de données officielles.
DES CONSÉQUENCES PROFONDES
La grossesse ou la maternité chez les adolescentes peut compromettre la santé, l’éducation, les possibilités d’emploi et l’avenir.
Selon une étude du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), les mères adolescentes (femmes ayant eu un enfant entre 10 et 19 ans) gagnent jusqu’à 28 % de moins que les mères jeunes adultes (femmes ayant eu un enfant entre 20 et 29 ans).
La grossesse chez les adolescentes affecte les projets de vie des jeunes mères, certaines abandonnant leurs études et leurs objectifs, et a un impact significatif sur les inégalités sociales.
En réponse à ce problème, le ministère bolivien de la santé a mis en place des centres de soins pour adolescents (AIDA) dans les établissements de santé publique. Selon Grágeda, il y a 10 centres dans le Cercado, deux dans le Sacaba et un dans le Vinto. Il est prévu d’implanter ces centres dans le cône sud et les vallées.
La Bolivie a l’un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d’Amérique latine. Il s’agit d’un problème de santé publique et d’une violation des droits des filles et des adolescentes. En réponse à cette situation, plusieurs collectifs et mouvements sont descendus dans la rue avec le slogan « Filles, pas mères », faisant allusion au fait que les mineures ne devraient pas être forcées à devenir mères.
Ce n’est un secret pour personne que les cas de violence sexuelle ont également augmenté, entraînant des grossesses.
Selon les statistiques du ministère public, mises à jour au 31 juillet de cette année, 1 478 cas de viols de nourrissons, d’enfants ou d’adolescents ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, 469 ont été signalés à Santa Cruz, 275 à Cochabamba, 271 à La Paz, 139 à Beni, 101 à Chuquisaca, 85 à Potosí, 77 à Tarija, 34 à Oruro et 27 à Pando. Au moins 80 % des agressions sexuelles sont commises par des membres de la famille ou des proches des victimes.
Il s’agit de cas signalés, car derrière eux se cachent des « chiffres noirs » qui ne sont pas révélés au grand jour.
NOTE COMPLÈTE DANS L’AVIS