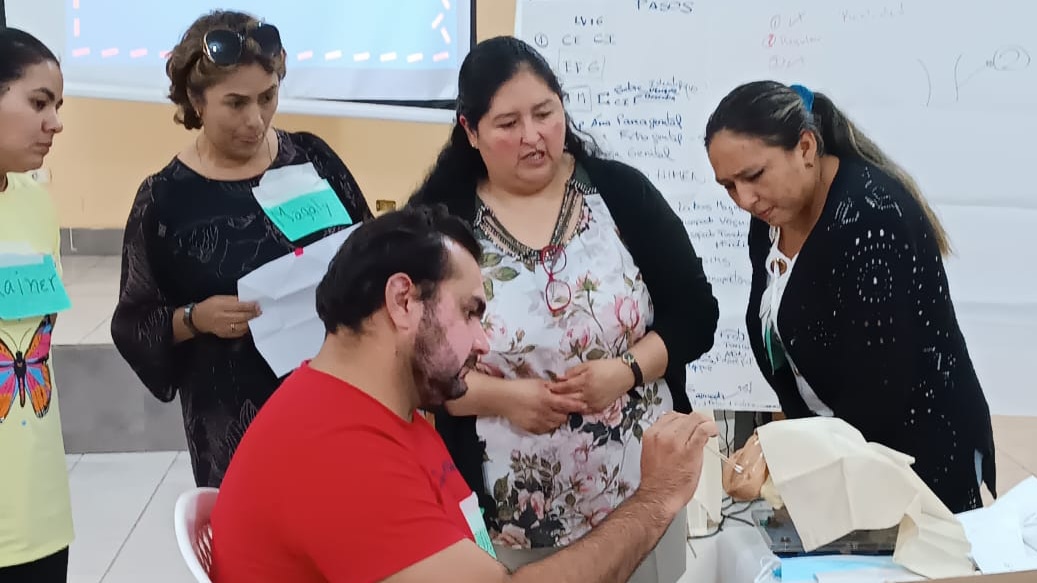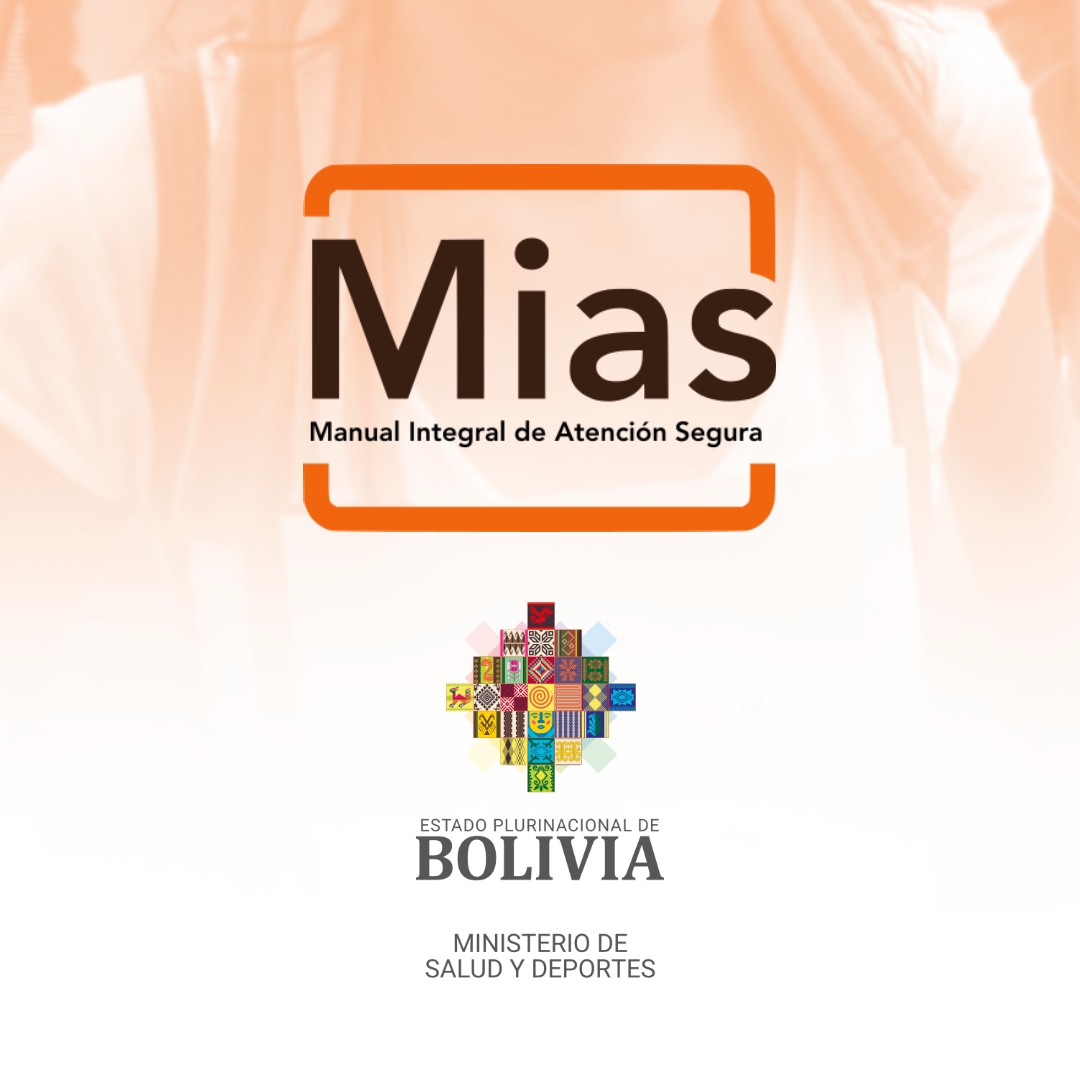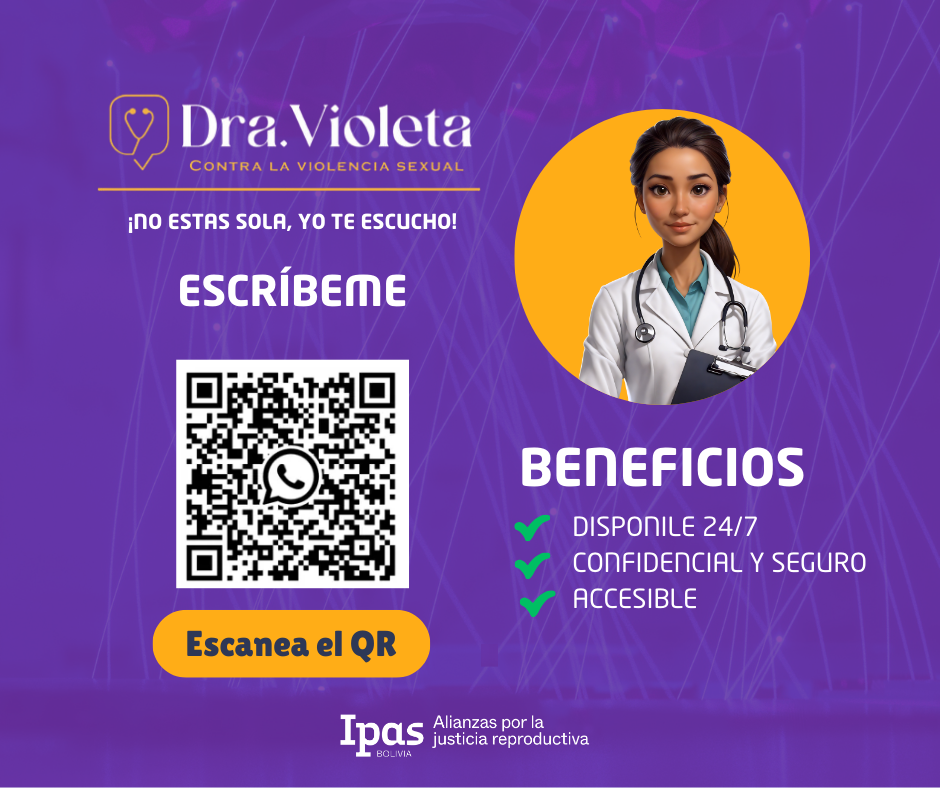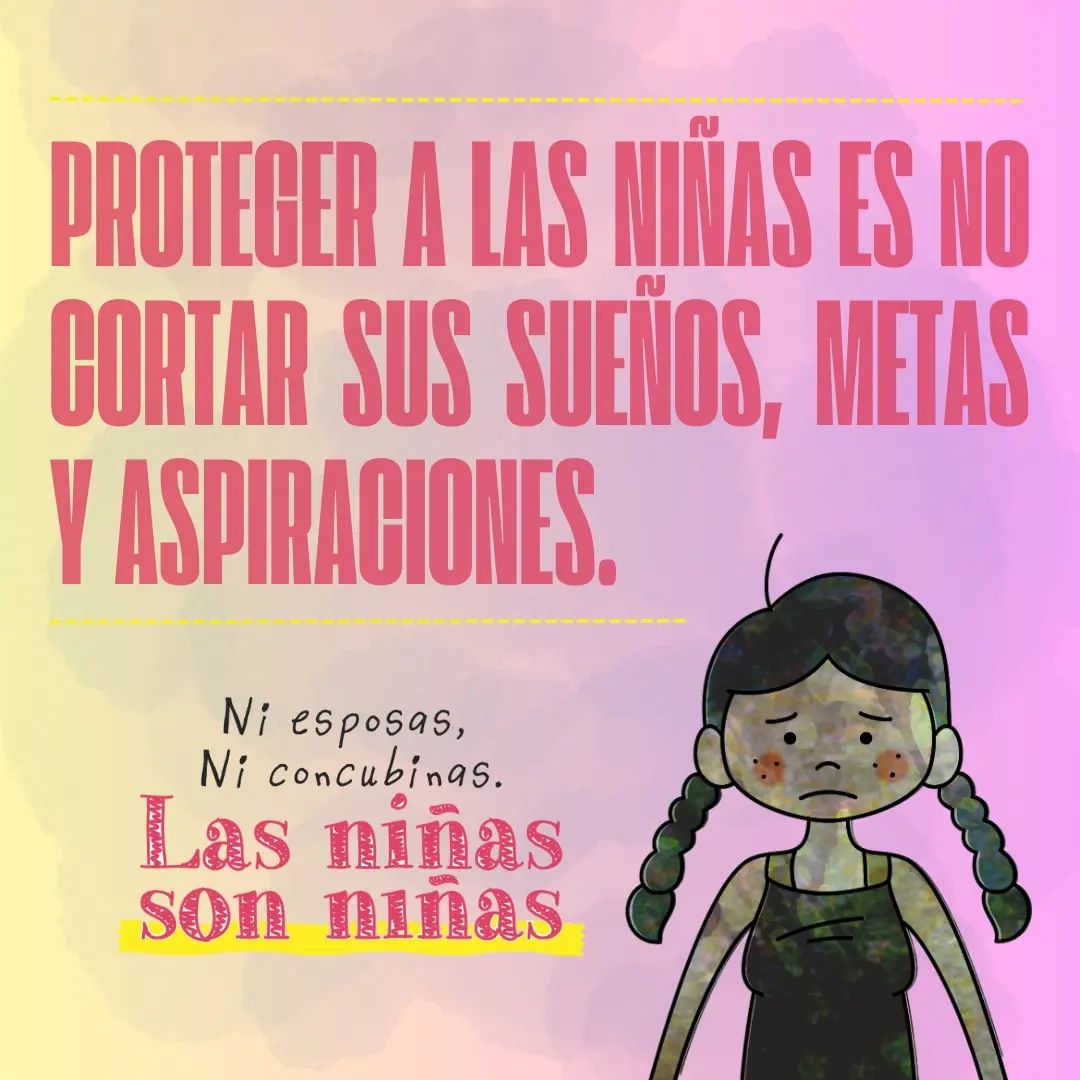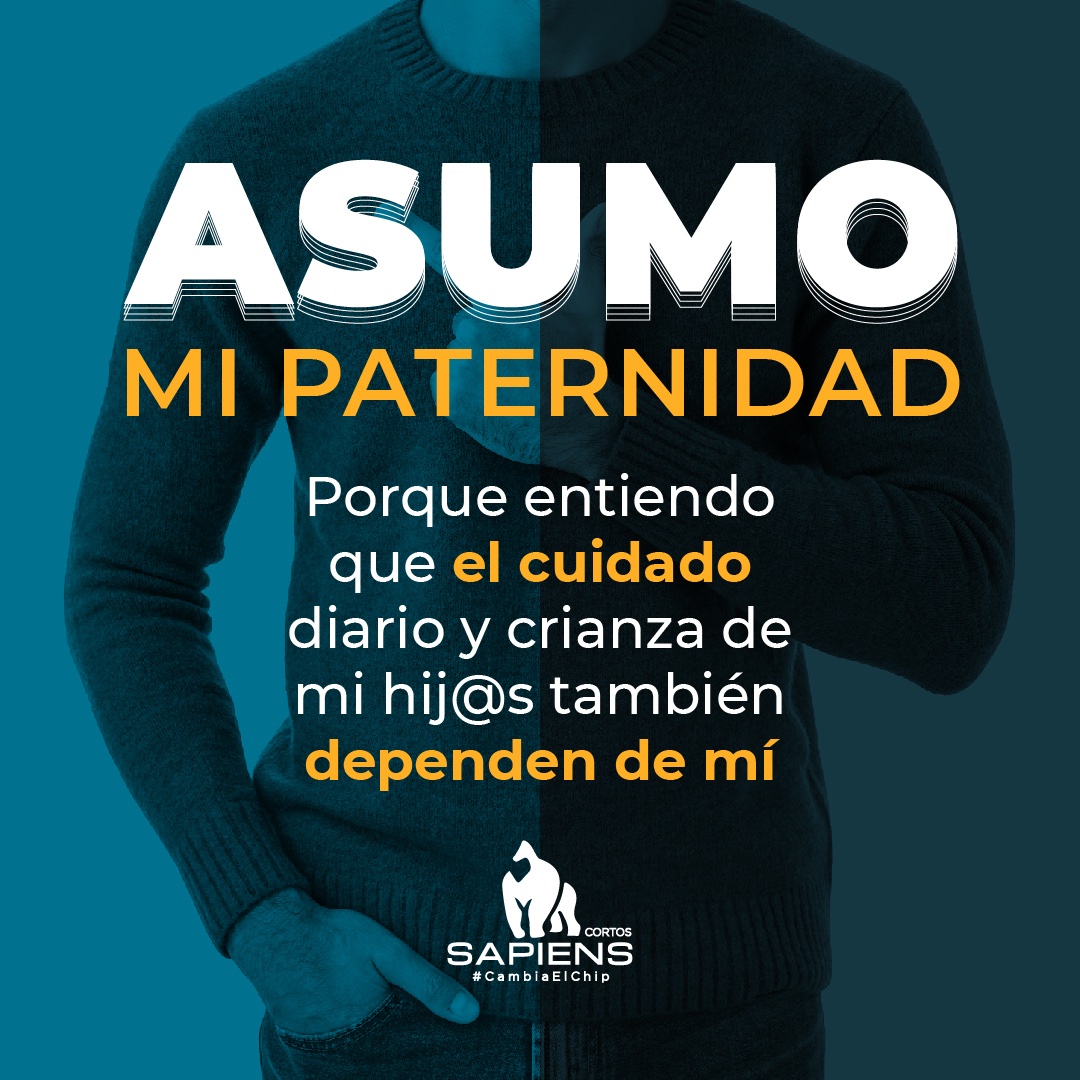En février de cette année, la Cour constitutionnelle colombienne a supprimé le délit d’avortement (jusqu’à 24 semaines de gestation) du code pénal, en réponse à une plainte déposée par Causa Justa, fer de lance d’une vaste campagne sociale et juridique impliquant plus de 120 mouvements et des milliers d’activistes.
La Colombie s’est ainsi placée « à l’avant-garde de la région et du monde », selon la médecin et militante féministe Ana Cristina González, l’une des porte-parole de Causa Justa.
La campagne, lancée en février 2020, « a été le résultat d’une accumulation politique nationale et internationale », qui a modifié « le débat public sur l’avortement en Colombie » et s’est transformée en « mouvement collectif et articulé », a déclaré Mme González lors d’une réunion à Montevideo.
L’avortement était totalement interdit en Colombie jusqu’en 2006, date à laquelle un arrêt de la Cour constitutionnelle, poussé par plusieurs militants de Causa Justa, l’a dépénalisé pour trois motifs : danger pour la santé ou la vie de la femme, incompatibilité du fœtus avec la vie extra-utérine et viol.
L’Uruguay a respiré le même air d’avant-garde en 2012, lorsqu’il a légalisé l’avortement jusqu « à 12 semaines, et l’Argentine en 2020, lorsque le Congrès a adopté une loi autorisant l’avortement jusqu » à 14 semaines, après une lutte de plusieurs dizaines d’années. La « marée verte », d’après la couleur des foulards de la campagne pour un avortement légal, sûr et gratuit, a inspiré et dynamisé toute la région.
Développements au Chili et au Mexique
Mais les frontières du possible continuent de s’étendre en Amérique latine.
Un mois à peine après la décision colombienne, la convention constitutionnelle chilienne - qui élabore une nouvelle constitution - a approuvé (à une large majorité) un article qui consacre les droits sexuels et génésiques comme fondamentaux et garantis par l’État. Ces droits incluent l’avortement.
L’article stipule que « toute personne a droit aux droits sexuels et reproductifs [qui comprennent, entre autres] le droit de décider librement, de manière autonome et éclairée, de son propre corps, de l’exercice de la sexualité, de la procréation, du plaisir et de la contraception ».
Il ajoute que l « État garantira l’exercice de ces droits “sans discrimination, en mettant l’accent sur l” égalité des sexes, l’inclusion et la pertinence culturelle » et « en garantissant à toutes les femmes et à toutes les personnes ayant la capacité d’avoir des enfants les conditions d’une grossesse, d’une interruption volontaire de grossesse, d’un accouchement volontaire et protégé et d’une maternité ».
L’avortement a été totalement interdit au Chili par la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1999) et n’est autorisé que depuis 2017 en cas de viol, de non-viabilité du fœtus et de risque pour la vie de la femme.
Si la nouvelle constitution est approuvée par un vote populaire en septembre, le Chili pourrait devenir le premier pays au monde à accorder un statut constitutionnel au droit à l’avortement.
L’année dernière, la Cour suprême du Mexique a déclaré inconstitutionnelle la criminalisation absolue de l’avortement et a invalidé une loi fédérale qui permettait au personnel de santé de refuser de pratiquer des avortements pour des raisons d' »objection de conscience ».
Cet arrêt signifie qu’aucune femme ne peut être emprisonnée pour avoir avorté, établit une jurisprudence et fait pression sur les États pour qu’ils légalisent l’avortement.
En fait, sept États mexicains ont déjà légalisé l’avortement volontaire dans les 12 premières semaines de grossesse, dont cinq depuis un an et demi : Mexico (2007), Oaxaca (2019), Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima (2021) et Sinaloa (2022).
Aujourd’hui, nous pouvons dire que 37 % de la population d’Amérique latine et des Caraïbes, soit 652 millions de personnes, vivent dans des pays où les femmes ont obtenu le droit d’avorter légalement ou de ne pas être emprisonnées pour avoir avorté (y compris Cuba, la Guyane et Porto Rico). Il y a cinq ans, cette proportion était inférieure à 3 %.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’activisme, les réseaux féministes, les mobilisations, le débat sur l’autonomie des femmes.
De plus, grâce aux progrès de la médecine et à l’innovation féministe, la mortalité liée à l’avortement n’a cessé de diminuer.
Entre 2005 et 2012, le taux de traitement des complications liées aux avortements à risque a diminué d’un tiers, selon l’Institut Gutmmacher, qui reconnaît que l’utilisation du médicament misoprostol « est devenue plus courante dans toute la région » et « semble avoir augmenté la sécurité des procédures clandestines ».
Une innovation féministe ? Ce sont des féministes latino-américaines qui ont reconnu, dans les années 1990, que le misoprostol était efficace et sûr pour interrompre une grossesse. Aujourd’hui, c’est un médicament recommandé par l’Organisation mondiale de la santé et adopté par les systèmes de santé de nombreux pays.
Ce sont également elles qui ont lancé une journée de lutte - la Journée mondiale d’action pour l’accès à l’avortement légal et sans risque - qui est désormais célébrée dans le monde entier le 28 septembre.
Il reste beaucoup à faire
Mais malgré ces progrès remarquables, des millions de personnes vivent toujours dans une réalité effroyable. L’avortement est totalement interdit au Salvador, en Haïti, au Honduras, au Nicaragua, en République dominicaine et au Suriname. Au Salvador, les femmes peuvent être condamnées à des peines allant jusqu’à 50 ans de prison pour une fausse couche ou une mortinaissance.
Au Belize, en Bolivie, au Brésil, au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala, au Panama, au Paraguay, au Pérou et au Venezuela, l’avortement n’est autorisé que dans des circonstances très limitées, généralement lorsque la santé ou la vie de la femme est menacée. Le Belize et la Bolivie prennent également en compte les difficultés économiques et familiales et, avec le Brésil et le Panama, le viol et les graves malformations du fœtus.
Les filles et les femmes violées sont contraintes d’accoucher non seulement dans les pays où l’interdiction est absolue, mais aussi au Costa Rica, au Guatemala, au Paraguay, au Pérou et au Venezuela. En Équateur, où le parlement a approuvé l’avortement en cas de viol, le président Guillermo Lasso a opposé son veto partiel à la loi.
Il y a peu d’espoir que les restrictions à l’avortement soient assouplies en Amérique centrale, mais le prochain grand changement pourrait intervenir dans le pays le plus peuplé, le Brésil, qui compte 212 millions d’habitants.
Dans ce pays, l’interruption de grossesse n’est autorisée qu’en cas de viol, de risque pour la santé de la femme ou d’anencéphalie du fœtus, et la pratique est entravée par le gouvernement d’extrême droite de Jair Bolsonaro, qui mobilise des groupes de fanatiques pour harceler les femmes et les professionnels de la santé.
Mais le Brésil organisera des élections en octobre et le favori actuel, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, a récemment déclaré qu’il était d’accord pour la légaliser.
Comme l’a dit Mme González de Causa Justa, une démocratie n’est pas complète lorsque la moitié de la population n’a pas la liberté de décider de son corps et de sa vie, notamment en raison de la criminalisation de l’avortement.
En bref, il s’agit d’une lutte pour la liberté et une véritable démocratie.
De l’autre côté de cette bataille, il y a des tentatives puissantes et coordonnées pour faire reculer les droits sexuels et génésiques durement acquis, non seulement en Amérique latine, mais dans le monde entier.
Ce retour de bâton inclut des réseaux internationaux et bien financés visant à désinformer et à manipuler les femmes et à promouvoir des pratiques non approuvées et potentiellement dangereuses, y compris un « traitement » visant à « inverser » les avortements à l’aide de médicaments - tous deux révélés par la recherche d’openDemocracy.
Il existe également des armées d’avocats bien rémunérés, formés par des groupes conservateurs internationaux pour plaider ou faire pression contre les droits des femmes. Ce sont ces mêmes groupes qui ont élaboré un programme détaillé pour mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement aux États-Unis.
Il semble de plus en plus possible que le mouvement anti-avortement y parvienne et pousse les femmes américaines dans un monde terrifiant d’arriération, de persécution et d’avortements clandestins et dangereux - un monde dans lequel leurs sœurs latino-américaines vivent depuis des décennies.
Mais à l’heure actuelle, les anti-avortement sont en train de perdre en Amérique latine. Et nous sommes en train de gagner.