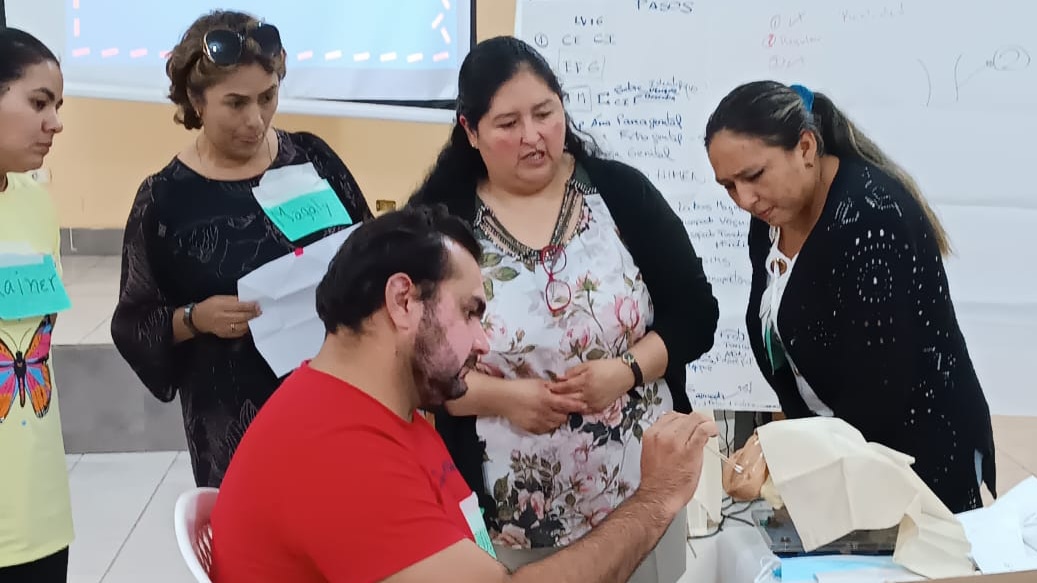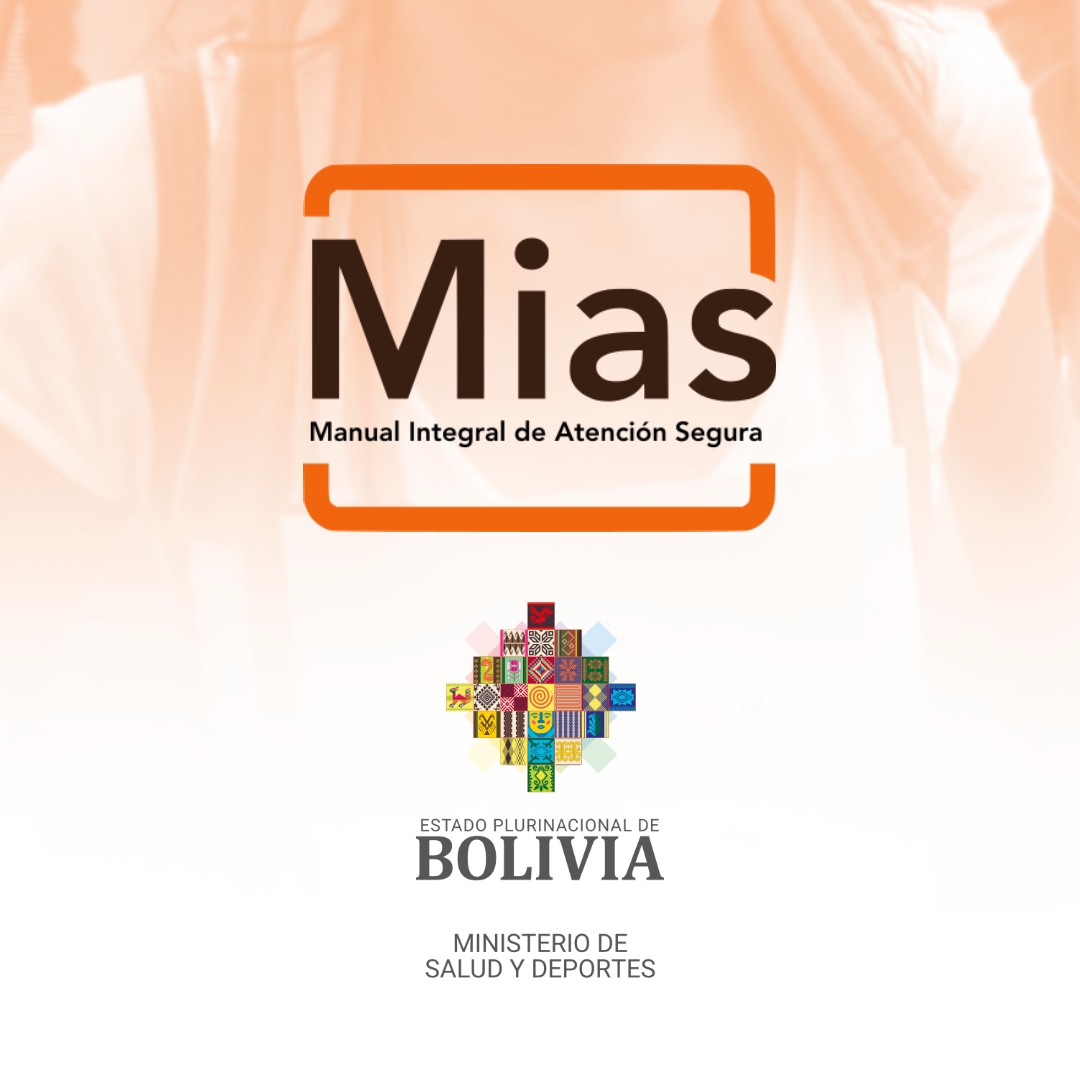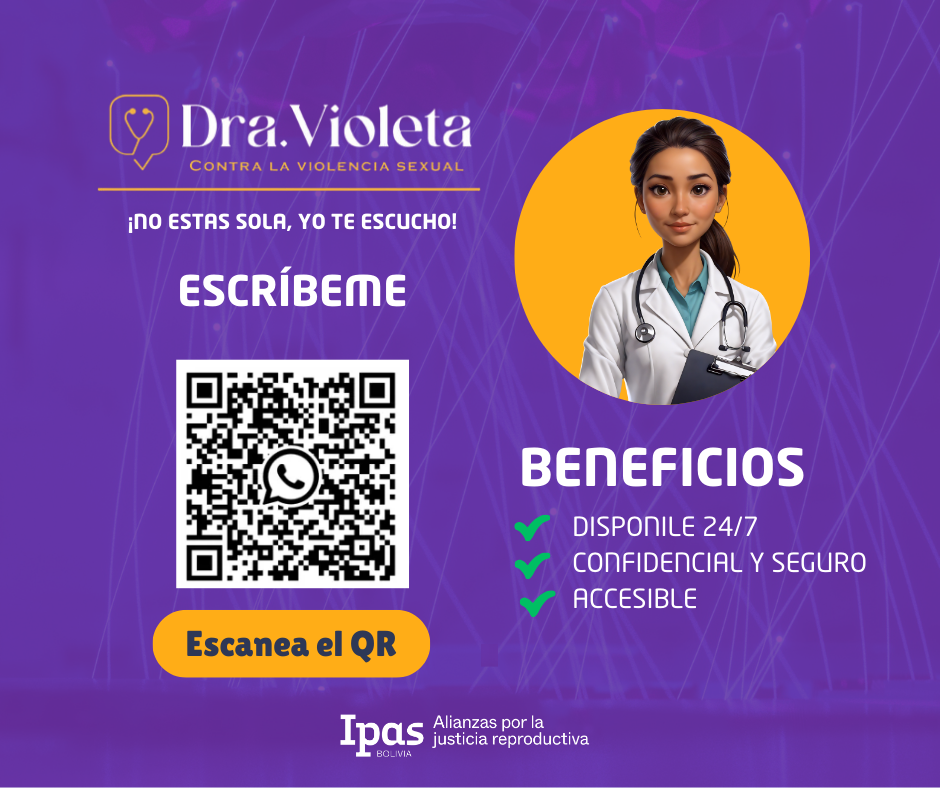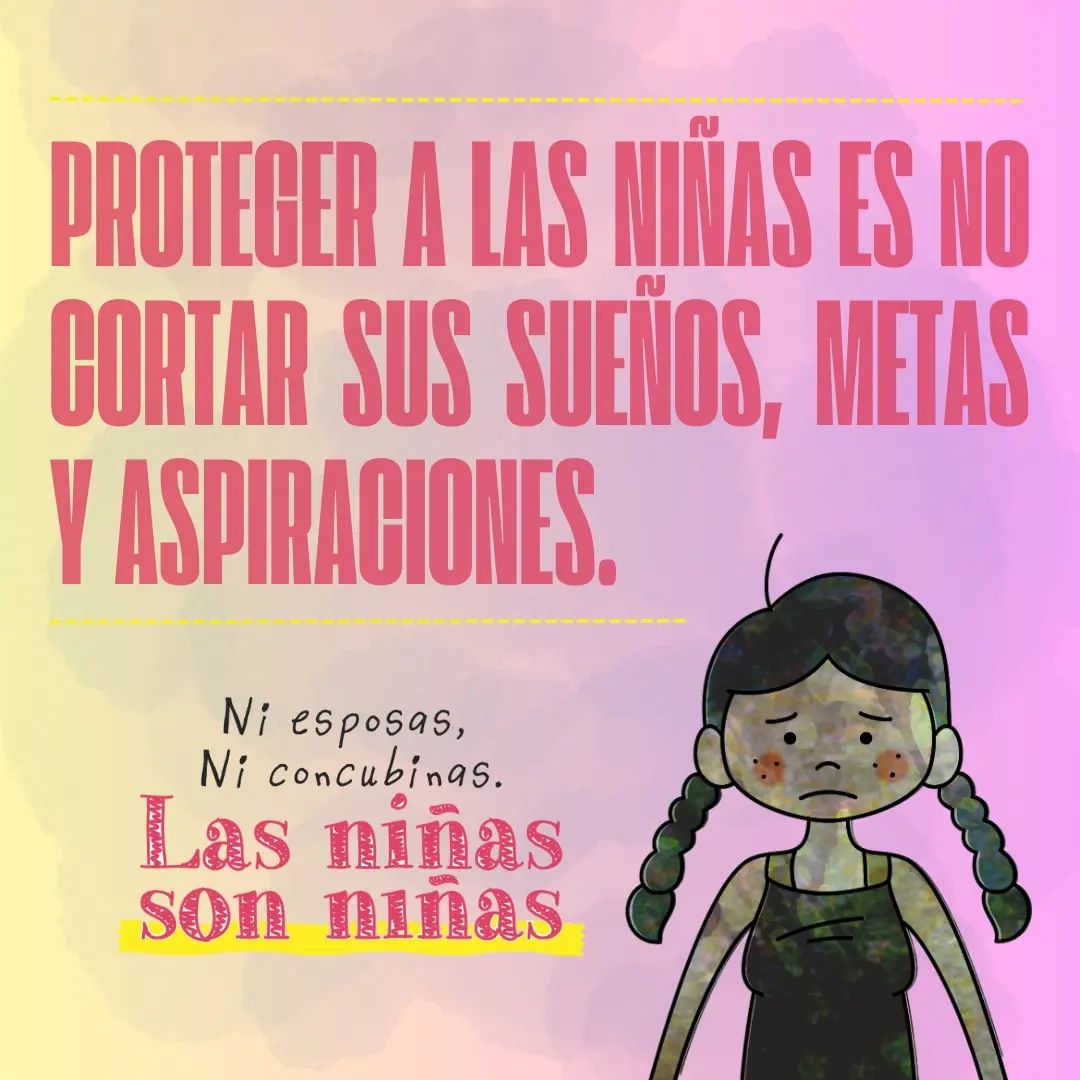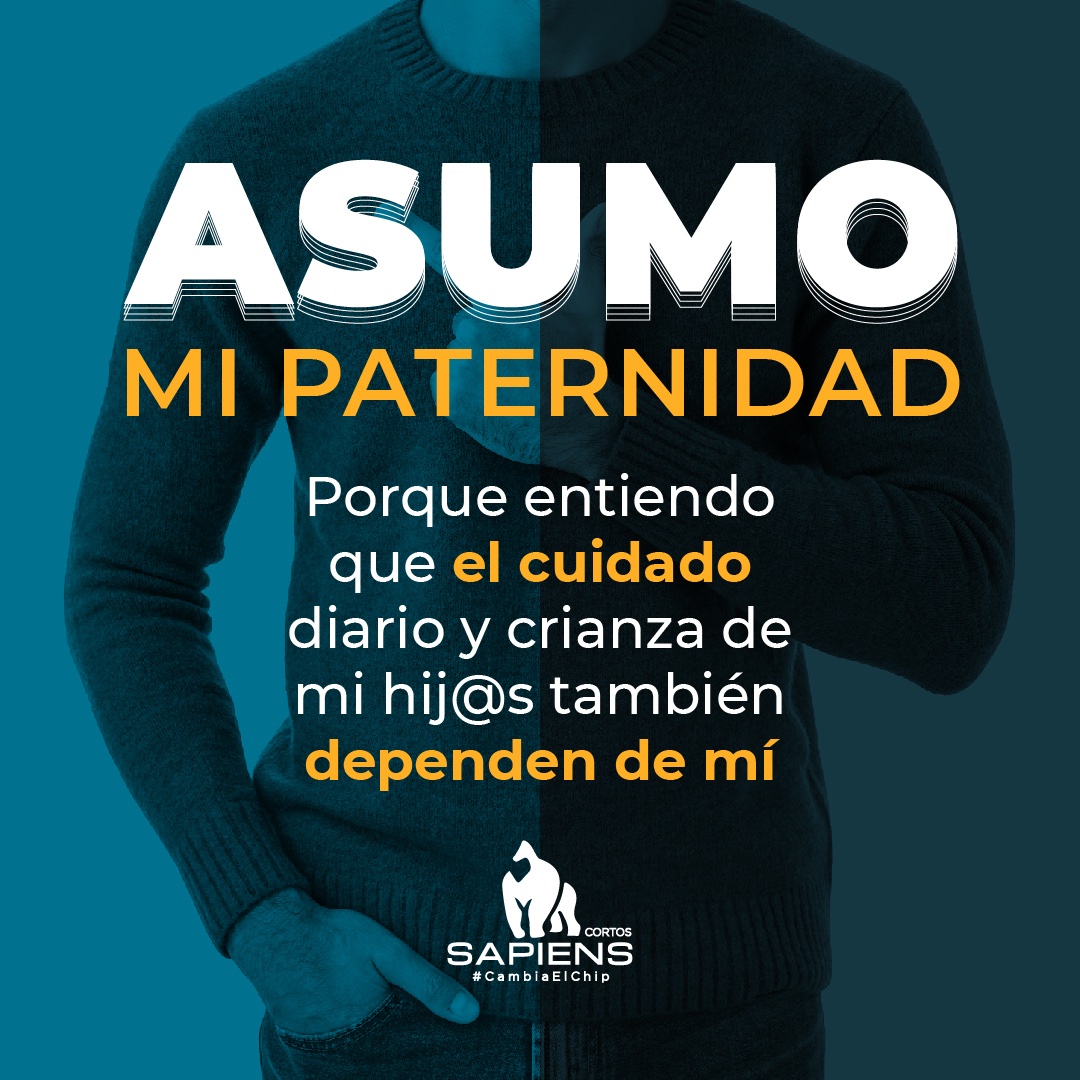Justyna Wydrzyńska, membre d’Avortement sans frontières et de l’Abortion Dream Team, a été condamnée au début de l’année pour avoir aidé une femme victime de violence masculine à accéder à des médicaments abortifs en Pologne. Lors d’une récente visite en Espagne, cette militante a expliqué à El Salto qu’une telle condamnation pouvait se produire n’importe où. L’avortement reste une pratique criminalisée dans le monde entier et les défenseurs de ce droit, ainsi que les professionnels de la santé et les médecins qui le pratiquent, sont largement persécutés. C’est ce que montre le dernier rapport d’Amnesty International intitulé Un mouvement imparable : appel mondial à la reconnaissance et à la protection des défenseurs du droit à l’avortement. Le rapport montre qu’ils sont stigmatisés, intimidés, attaqués et injustement poursuivis, ce qui rend leur travail de plus en plus difficile et dangereux. Nous nous sommes entretenus avec Lisa Maracani, auteur du rapport et chercheuse au Global Human Rights Defenders Programme, qui souligne la vulnérabilité à laquelle les droits à l’avortement sont exposés à l’échelle mondiale, même dans les pays où la législation est très avancée.
Quelle est la principale conclusion que vous avez tirée du rapport ?
Les défenseurs du droit à l’avortement, qu’il s’agisse de militants, d’accompagnateurs ou de prestataires de soins de santé, sont attaqués de diverses manières parce que le droit à l’avortement continue d « être criminalisé - seul un pays, le Canada, a complètement dépénalisé l’avortement - et aussi à cause de la stigmatisation qui entoure ce droit. Au lieu d » être considéré comme un droit et un soin de santé essentiel, l’avortement continue d « être traité comme une exception et quelque chose qui doit être strictement réglementé. Les attaques contre les défenseuses des droits humains constituent non seulement une violation de l’obligation de l » État de protéger les défenseuses des droits humains et de leur fournir un environnement sûr et favorable, mais aussi un obstacle au droit à l’avortement pour toutes celles qui en ont besoin.
Quelle est l’ampleur de la persécution des personnes qui défendent les droits génésiques des femmes ? Combien de cas avez-vous documentés ?
Pour ce rapport, nous nous sommes entretenus avec près de 50 personnes originaires de 30 pays du monde entier et travaillant dans des contextes différents, allant des plus répressifs (par exemple le Salvador) à ceux considérés comme plus ouverts (par exemple le Royaume-Uni). Toutes les personnes interrogées ont déclaré avoir subi une forme ou une autre d’hostilité ou de contrainte, par exemple : stigmatisation (y compris par des collègues), agressions physiques ou verbales, criminalisation (ou risque de criminalisation), intimidation, campagnes de diffamation, entraves à leurs droits fondamentaux (par exemple, liberté d’expression et d’association) et à leur carrière.
Aux États-Unis, entre 1977 et 2022, 11 homicides, 26 tentatives d’homicide et 200 incendies criminels ont été enregistrés à l’encontre de prestataires de services de procréation féminine.
Le rapport cite également des études plus larges réalisées par d’autres organisations (par exemple, Ipas et d’autres prestataires de services sexuels et reproductifs). Les attaques violentes au niveau mondial n’ont pas été systématiquement documentées au fil des ans, mais aux États-Unis, une organisation, la National Abortion Federation, a enregistré tous les incidents violents à l’encontre des prestataires depuis les années 1970. Par exemple, entre 1977 et 2022, elle a enregistré 11 homicides, 26 tentatives d’homicide, 200 incendies criminels, 100 attaques à l’acide, plus de 500 agressions, soit un total de près de 16 000 incidents violents.
En général, le problème réside dans l’invisibilité globale de ces attaques, qui sont pourtant quotidiennes pour ces défenseurs. Dans de nombreux cas, les risques sont intériorisés, ce qui crée beaucoup d’attrition et de traumatismes. Il est essentiel que les États, les hôpitaux, les syndicats ou les associations professionnelles documentent ce problème et prennent des mesures urgentes pour protéger tous les défenseurs du droit à l’avortement.
Le droit à l’avortement est-il menacé au niveau international ?
Oui, d’énormes obstacles à l’accès à un avortement sûr subsistent dans le monde entier, malgré les progrès importants réalisés au cours des dernières décennies. Ces progrès ont été réalisés principalement grâce au travail des mouvements féministes, qui ont fait évoluer les normes en matière de droits de l’homme sur l’avortement, l’adoption d’une législation progressiste et les décisions de justice qui reconnaissent de plus en plus le droit à l’avortement.
Des progrès ont également été réalisés grâce au développement et au déploiement de médicaments abortifs dans le monde entier, de sorte que l’avortement est devenu plus accessible et plus acceptable pour des millions de femmes, de jeunes filles et de personnes susceptibles de tomber enceintes, qui ont gagné en autonomie et en contrôle de leur corps.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Aujourd’hui, l’avortement reste criminalisé et fortement réglementé dans la plupart des pays, et une interdiction totale de l’avortement persiste dans 22 pays. Même lorsque des réformes législatives progressives ont eu lieu, l’accès à un avortement légal et sûr peut s’avérer difficile en raison d’obstacles importants, en particulier pour les personnes les plus marginalisées. En outre, les opposants à l’avortement s’efforcent d’inverser les progrès réalisés. Ces efforts gagnent du terrain dans un contexte de discours public anti-avortement et anti-genre, d « érosion de l » État de droit, de campagnes de désinformation et d’attaques contre l’espace de la société civile. Dans tous les pays du monde (à l’exception du Canada), elle persiste dans les codes pénaux.
Les personnes travaillant dans les services de santé nous ont dit qu’elles étaient confrontées à un conflit profond entre la fourniture des meilleurs soins médicaux possibles et le risque d’être criminalisé.
Cette répression s’exerce même dans les pays qui autorisent partiellement l’avortement.
Oui, rien qu’au Canada, malgré la dépénalisation totale de l’avortement, il y a des cas d’agressions violentes. Cela s’explique par le fait que la dépénalisation seule ne suffit pas. Il est également important de lutter contre la stigmatisation, de mener des campagnes d’éducation et de prendre des mesures concrètes pour protéger les défenseurs et les personnes qui recherchent des services de santé.
Le fait qu’il existe des lois qui réglementent fortement les droits à l’avortement signifie qu’il y a beaucoup de stigmatisation et de risque de criminalisation des prestataires et des activistes, même lorsqu’ils agissent dans les limites strictes de la loi. En outre, les personnes travaillant dans les services de santé nous ont dit qu’elles ressentaient un fort conflit entre le devoir éthique et professionnel de fournir les meilleurs soins médicaux possibles et le risque d’être criminalisé par des lois qui sont en fait préjudiciables à la santé.
En quoi consiste cette répression, et y a-t-il même un risque d’homicide ?
Oui, par exemple aux États-Unis, il y a eu des cas d’assassinats, de tentatives d’assassinat et d’autres attaques violentes au fil des ans. Il y a bien d’autres pays où les prestataires de droits sexuels et génésiques risquent leur vie, comme nous l’ont dit les personnes que nous avons interrogées, mais il n’existe pas d’informations systématiques, ce qui rend ces attaques invisibles.
Même si l’avortement est légalisé, les professionnels de la santé qui pratiquent des avortements sont-ils encore stigmatisés ?
Oui, c’est le cas dans tous les pays. La stigmatisation est l’un des problèmes dont toutes les personnes que nous avons interrogées nous ont parlé. La stigmatisation est essentielle parce que les personnes qui défendent le droit d’accès aux soins de santé essentiels, y compris l’avortement, remettent en question, par leur travail, les systèmes de pouvoir et d’oppression tels que le patriarcat et le racisme.
En Espagne, une liste d’objecteurs de conscience a été rendue obligatoire pour garantir l’accès à l’avortement dans tous les hôpitaux publics. Les professionnels qui ne veulent pas pratiquer d’avortements doivent le dire, afin de garantir que dans tous les centres, il y ait au moins un professionnel qui pratique des avortements. Que pensez-vous de cette mesure ?
Il s’agit d’une première étape, mais tout dépendra de la manière dont elle sera mise en pratique et de ce que l’État fera pour garantir le droit à l’avortement s’il y a trop d’opposants. Par exemple, en Italie, les professionnels de la santé doivent également déclarer s’ils sont opposants et, en théorie, le ministère de la santé devrait utiliser ces données pour s’assurer que la loi autorisant l’avortement est respectée. Bien que le ministère de la santé soit parfaitement conscient de l’existence d’un niveau élevé d’objection (les données officielles donnent une moyenne de 64 %, mais il y a des pics de 84 % dans certaines régions et il y a des hôpitaux où 100 % du personnel est objecteur), l’État est toujours « dans le déni » et très peu de mesures ont été prises pour remédier à ce problème. Par exemple, en 2015, le Conseil de l’Europe a condamné l’ Italie pour les niveaux très élevés de discrimination et la charge de travail excessive auxquels est confrontée la minorité du personnel de santé non objecteur. Cette situation fait que, malgré la loi qui prévoit l’accès à l’avortement au cours du premier trimestre de la grossesse, la réalité est très différente.
Chaque année, 35 millions d’avortements sont pratiqués dans des conditions dangereuses. Le manque d’accès à l’avortement médicalisé contribue à des niveaux élevés de mortalité et de morbidité maternelles.
La stigmatisation de la profession médicale empêche-t-elle les femmes d’accéder à ce droit ? Quelles sont les femmes les plus vulnérables ?
Oui, c’est l’un des points cruciaux que nous voulons communiquer. Il ne s’agit pas seulement des attaques contre les défenseurs, y compris le personnel médical, mais aussi de l’impact sur toutes les personnes qui dépendent de services de santé accessibles et abordables. Chaque année, 35 millions d’avortements non médicalisés sont pratiqués dans le monde, principalement en Afrique (à l’exception de l’Afrique du Sud), en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Asie du Sud et en Asie centrale. Le manque d’accès à l’avortement médicalisé contribue à des niveaux élevés de mortalité et de morbidité maternelles. Comme toujours, les personnes les plus touchées sont celles qui sont pauvres, marginalisées, jeunes, victimes de discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique ou tout autre statut, et qui vivent loin des services de santé. Le manque d’accès à l’avortement a donc toujours été une question de justice sociale.
Ce matériel est partagé avec l’autorisation de El Salto